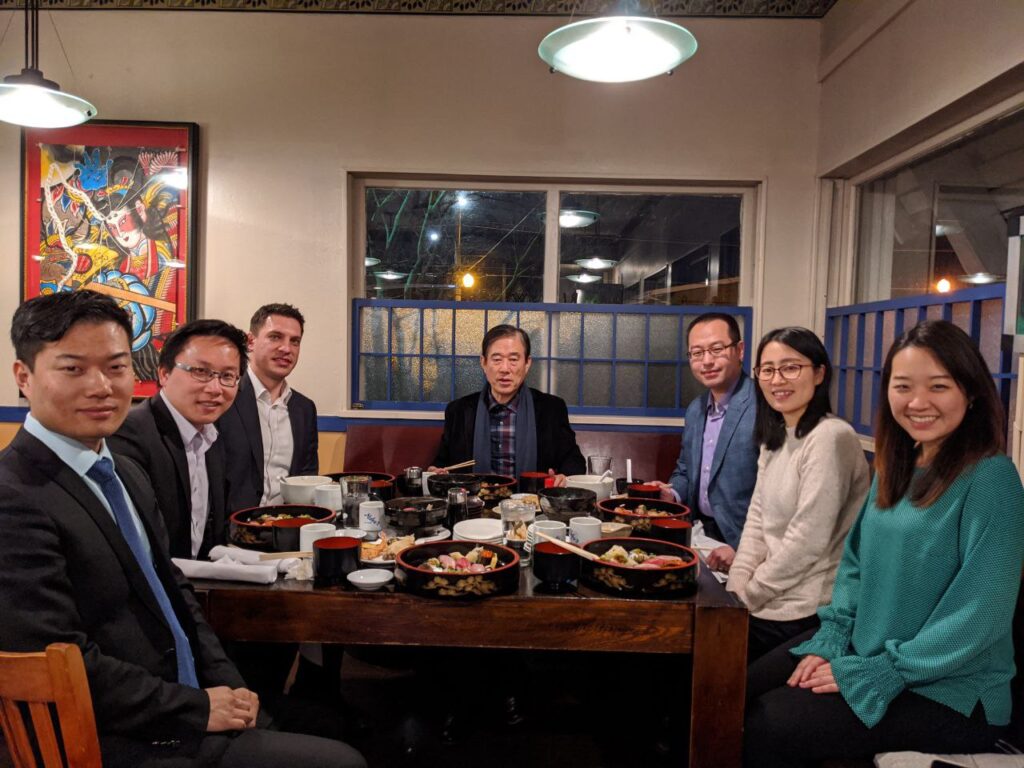1. L’essence de la reconnaissance
Qu’est-ce que la reconnaissance ? Nous avons souvent tendance à nous montrer reconnaissants lorsque quelque chose de bon se produit dans notre vie ou lorsque nos désirs se réalisent. Pourtant, le message de reconnaissance que l’apôtre Paul transmet dans Colossiens 3.15-17 diffère légèrement de cette vision courante. Il déclare : « Soyez reconnaissants » (Col 3.15) et affirme ainsi que c’est la volonté de Dieu pour nous, chrétiens, de « devenir des personnes reconnaissantes ». En même temps, il nous exhorte : « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs » (Col 3.15). Cette exhortation suggère que le point de départ de la reconnaissance ne réside pas dans notre situation extérieure, mais dans la paix de Christ, c’est-à-dire la paix spirituelle découlant de notre réconciliation avec Dieu.
Cette paix que nous possédons par la foi n’a rien à voir avec une simple sécurité psychologique ou une consolation passagère. Lorsque Paul déclare « que la paix du Christ règne dans vos cœurs », il nous invite à laisser, en quelque sorte, la paix déjà donnée par le Christ occuper la place centrale de notre cœur, et à nous abandonner à son gouvernement. Et cette paix que nous recevons en Christ nous conduit à rendre grâce en toutes circonstances. Dans de nombreux sermons et expositions, le pasteur David Jang a souligné à plusieurs reprises que « la reconnaissance est une force qui transcende les limites et les situations humaines, et qu’elle est le fruit de vie que le Christ nous a accordé ». Le salut que nous recevons par la grâce de Dieu dépasse le simple fait d’être rassurés quant à l’avenir : il imprègne nos circonstances présentes de paix. C’est un don que nous avons reçu gratuitement, sans être fondé sur notre propre justice, nos mérites ou nos actes. Puisqu’il est le résultat unique de la croix et de la résurrection du Christ, la première et plus importante reconnaissance doit porter sur cette paix spirituelle.
Avant que la paix du Christ ne pénètre dans notre vie, nous étions spirituellement ennemis de Dieu. À cause du péché, un mur s’était dressé entre Dieu et nous, notre relation était rompue. Mais en offrant sa propre vie en sacrifice de réconciliation, Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu et nous a ouvert la voie pour jouir, au plus profond de notre cœur, de la vraie paix. C’est ce que la Bible appelle la « grâce et la paix ». Les salutations des épîtres de Paul comportent souvent la formule « Que la grâce et la paix vous soient données », démontrant ainsi que ces deux réalités constituent les piliers centraux de la vie de foi. Quand la paix règne en notre cœur, nous pouvons enfin rendre grâce en toutes circonstances.
Par conséquent, le commandement de « rendre grâce en toutes choses » (1 Thessaloniciens 5.18) explique finalement l’attitude de reconnaissance fondée sur la paix de Christ. La reconnaissance ne se réduit pas à un comportement moral ou à de la politesse du type : « Je suis reconnaissant, car cela s’est accompli ». Elle commence par la prise de conscience de notre réconciliation avec Dieu. À maintes reprises, le pasteur David Jang l’a rappelé : « Celui qui ne connaît pas la reconnaissance demeure finalement aveugle à la paix que Dieu nous offre ; il reste dans un état de cécité spirituelle ». La paix humaine et terrestre diffère totalement de la paix spirituelle que nous recevons par la grâce de Dieu. La première se brise facilement au gré des circonstances, tandis que la seconde demeure inébranlable, quelles que soient les situations. Voilà pourquoi nous devons constamment nous interroger : « Est-ce que la paix de Christ gouverne véritablement mon cœur à cet instant ? »
Dans Colossiens 3.15, l’apôtre Paul déclare : « À cette paix, en vue de laquelle vous avez été appelés à former un seul corps, soyez reconnaissants ». La reconnaissance est ainsi la voie pour répondre dignement à l’appel de Dieu, et devient aussi la clé de l’harmonie mutuelle au sein de la communauté ecclésiale. En effet, la paix donnée par le Christ ne se limite pas à une expérience individuelle : c’est une bénédiction communautaire que partagent tous ceux qui ont été appelés à former un seul corps. Quand tous les membres de ce corps, ayant un seul et même chef, le Christ, jouissent de la même paix, ils peuvent enfin vivre dans la compréhension mutuelle, l’acceptation et l’amour, en étant « unis par la reconnaissance », plutôt que dans les disputes et les conflits.
Une telle paix ne se conquiert pas par nos propres efforts, mais ne s’obtient que par la grâce de Jésus-Christ. C’est pourquoi nous devons, jour après jour, nous souvenir de la grâce de Christ et devenir des personnes reconnaissantes. Si nous perdons de vue cette reconnaissance, notre vie spirituelle s’assèche comme une source à sec. Quand notre motif de reconnaissance repose sur notre situation, nos capacités ou l’apaisement temporaire offert par le monde, nous perdons la force qui anime fondamentalement la reconnaissance. C’est la raison pour laquelle Paul insiste, dans l’épître aux Colossiens, sur le fait que « la paix de Christ doit régner dans nos cœurs ».
Comme le répète souvent le pasteur David Jang, la reconnaissance est un des principaux indicateurs de l’identité chrétienne. Celui qui reçoit Jésus-Christ et le salut se voit immanquablement habité d’un cœur reconnaissant. Non pas à cause de quelque chose de supplémentaire que nous aurions accompli, mais parce que nous réalisons pleinement la « réalité de la grâce » déjà accordée par Dieu, qui suscite en nous une réponse naturelle d’action de grâce. Plus nous avançons sur la voie de la foi, plus notre reconnaissance s’approfondit et s’enrichit. Et à mesure qu’elle s’enracine en nous, nous ne sommes plus dominés par la crainte, le souci ni l’angoisse, mais au contraire par la paix et la joie.
En effet, lorsque le pasteur David Jang a créé et développé, dans de nombreux pays du monde, divers établissements d’enseignement et associations caritatives pour y prêcher l’Évangile, l’un des principes mis en avant était : « Deviens une personne reconnaissante ». Il répétait souvent : « Toutes les opportunités, toutes les voies et tous les moyens que Dieu nous ouvre pour nous les fournir, relèvent de sa grâce infinie. En conséquence, rends d’abord grâce et retourne à Dieu cette reconnaissance sous forme de louange. » Que ce soit pour servir les nécessiteux, aider les pauvres, ou porter la Parole aux âmes qui la désirent ardemment, le point de départ de chaque mission était toujours la reconnaissance. Se souvenir de ce que Dieu nous a accordé est en effet la motivation la plus saine et la plus juste pour s’engager dans le service.
La reconnaissance ne reste pas seulement au niveau spirituel, mais exerce une influence sur notre vie tout entière. Dans Colossiens 3.17, Paul déclare : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père. » Ainsi, chacune de nos paroles et chacun de nos actes peuvent constituer un culte de reconnaissance devant Dieu. Si, de nos lèvres, nous déclarons notre reconnaissance, mais que nous rejetons la paix et la grâce de Christ dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous offrons une action de grâce véritable. Celui qui garde la paix de Dieu dans son cœur sait naturellement rendre grâce en toutes choses, et cette gratitude s’exprime alors concrètement par ses paroles et par ses actes, devenant ainsi le « culte » de sa vie.
Surtout, pour rendre grâce en toutes circonstances, il faut sans cesse se rappeler les œuvres de Dieu. Si nous oublions la grâce du salut que Christ nous a accordé, notre élan à rendre grâce s’éteint. Voilà pourquoi, dans Colossiens 3.16, Paul ajoute : « Que la parole de Christ habite en vous abondamment ». Rester attaché à la Parole, ne pas l’oublier, l’appliquer à notre existence et y prendre racine constitue le secret pour ancrer notre reconnaissance de plus en plus profondément. Le pasteur David Jang souligne régulièrement l’importance de la méditation de la Parole, avertissant : « Si nous ne gardons pas les yeux fixés sur la Parole de Dieu, nous risquons de perdre la mémoire de la grâce et de laisser les préoccupations du monde prendre la place de la paix de Christ dans notre cœur. »
En résumé, l’essence de la reconnaissance ne dépend pas des réalisations ou des circonstances extérieures. Elle prend sa source dans la prise de conscience de notre réconciliation avec Dieu et du fait que nous avons reçu la paix spirituelle par la croix de Christ. Et quand cette paix gouverne notre cœur, nous pouvons rendre grâce en toute circonstance. Être une « personne reconnaissante » est un élément fondamental de la vie du véritable chrétien. Le point clé que le pasteur David Jang a constamment enseigné est le suivant : le commandement « Rendez grâce » n’a rien d’exigeant ni de dépouillant, mais représente plutôt une invitation à contempler la surabondance de la grâce déjà déversée, afin d’en profiter pleinement et de rendre gloire à Dieu.
Conscient de cet ordre spirituel, nous sommes appelés à voir éclore la culture de la reconnaissance dans notre vie personnelle, au sein de la communauté ecclésiale et dans la société. Voilà le point central souligné dans ce premier grand thème : comprendre correctement la « nature de la reconnaissance », pour en faire le pilier central, et non un simple ornement extérieur, de notre vie de foi. Pour préserver ce pilier, nous devons constamment nous recentrer sur la « paix de Christ ». Ce n’est que lorsque cette paix règne dans notre cœur que nous pouvons vraiment rendre grâce en toutes choses et glorifier Dieu de manière authentique.
2. Une vie offerte dans la reconnaissance
Nous avons vu précédemment que la reconnaissance naît de la paix spirituelle que nous confère le Christ. À présent, en nous penchant sur Colossiens 3.16-17, examinons plus concrètement la manière dont cette reconnaissance se manifeste au quotidien. Dans le verset 16, Paul déclare : « Que la parole de Christ habite en vous abondamment ; instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en lui rendant grâce. » Puis, au verset 17, il insiste : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père. » Cela signifie que la totalité de nos paroles et de nos actes doit s’élever comme un sacrifice de reconnaissance devant Dieu.
Dans un premier temps, l’une des manifestations les plus directes de la reconnaissance est la louange. Les auteurs des Psaumes rendent constamment gloire à Dieu par le chant, et il leur arrive d’assimiler la louange à un « sacrifice » (comme dans le Psaume 50). De la même manière, Hébreux 13.15 déclare : « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » La louange constitue donc une forme de sacrifice très précieux et pur offert par le croyant. Le pasteur David Jang souligne souvent dans ses prédications que « le sacrifice de la louange et de la reconnaissance dépasse en valeur celui de taureaux », expliquant que cette louange reconnaissante est un culte spirituel, qui ne se limite pas à un simple rituel extérieur, mais unit notre cœur, notre bouche et notre esprit.
Le passage de Colossiens 3.16 nous interpelle particulièrement lorsqu’il mentionne que, par les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels, nous devons nous instruire et nous exhorter mutuellement. On sait qu’à l’époque de l’Église primitive, les croyants se réunissaient pour rompre le pain et partager un repas, tout en chantant ensemble les Psaumes et des cantiques (Actes 2). Cette louange partagée en communauté exprimait à la fois reconnaissance et gloire rendues à Dieu, tout en édifiant et en encourageant les membres à progresser dans la grâce. Lorsque la louange, remplie de reconnaissance, retentit au sein d’une communauté, elle consolide les liens entre les croyants et fortifie l’amour fraternel en Christ.
Cependant, bien que la louange soit une expression essentielle de notre reconnaissance, Paul insiste pour que nous n’en restions pas là : il invite à manifester la reconnaissance « en parole et en action ». Autrement dit, non seulement notre langage doit glorifier le nom du Seigneur Jésus, mais l’ensemble de notre vie dans le monde – chacune de nos activités – doit se faire au nom du Seigneur et, par sa grâce, nous devons rendre grâces à Dieu le Père. Il arrive que certains croyants soient emplis de reconnaissance lorsqu’ils chantent à l’église, mais qu’une fois franchie la porte de l’assemblée, ils se laissent aller au mécontentement ou au découragement, sous le poids des soucis quotidiens. Or, si nous sommes vraiment appelés à rendre grâce en toutes choses, nous devons apprendre à témoigner de cette reconnaissance en toute occasion et en tout lieu, et faire de chacune de nos paroles et de chacun de nos actes une louange rendue à Dieu.
Le pasteur David Jang qualifie cela de « vie devenue culte ». Bien qu’il y ait un temps de culte fixé, la vie entière du chrétien doit être un culte. Quand nos paroles plaisent à Dieu, quand nos comportements reflètent le caractère de Christ et quand nos décisions suivent la justice divine, alors toute notre existence s’élève comme un culte à Dieu. Si nous adoptons ainsi une vie centrée sur Dieu, la reconnaissance cesse d’être une prière occasionnelle pour devenir une attitude spontanée à chaque instant de notre vie.
En outre, la reconnaissance se manifeste encore plus clairement lorsque nous nous acquittons de la mission qui nous est confiée. Paul explique que quand nos paroles et nos actes sont accomplis « au nom du Seigneur Jésus », notre reconnaissance s’exprime devant Dieu. Cela signifie que dans tous les domaines de notre vie – service d’Église, activité professionnelle, engagements familiaux, études, vie sociale –, nous devons nous demander : « Comment accomplir ces tâches selon la volonté et l’amour du Seigneur ? » Si nous essayons d’agir en tout conformément à la volonté de Christ, cela devient déjà un culte de reconnaissance envers Dieu, car dans un tel chemin, nous ne cherchons pas notre propre volonté, mais nous honorons le gouvernement de Dieu et lui rendons gloire.
Lorsque le pasteur David Jang a implanté des Églises, des écoles et des organisations caritatives à travers le monde, il a toujours veillé à ce que la reconnaissance ne soit pas seulement dans les paroles, mais qu’elle s’incarne dans un engagement concret et un partage effectif – une « vie qui témoigne de la reconnaissance ». Par exemple, établir une école dans une région pauvre pour offrir nourriture et éducation, prêcher la Bonne Nouvelle là où règnent misère et injustice tout en prenant soin des besoins concrets des populations, aider des âmes en quête de la Parole à se former et à envisager leur avenir avec espoir : tout cela est un prolongement concret de l’amour « au nom du Seigneur Jésus ». C’est précisément vivre l’appel de Colossiens 3.17 : « Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâces à Dieu le Père par lui. »
Parce que la reconnaissance englobe toutes nos paroles et toutes nos actions, une gratitude authentique ne saurait se limiter à une simple profession de lèvres. Nous pouvons, certes, honorer Dieu par des psaumes et des cantiques, mais si nous négligeons de regarder autour de nous, de servir ceux qui souffrent et de traduire l’amour en actes, la reconnaissance que nous prétendons ressentir ne sera jamais véritablement accomplie. Le verset « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre… » contient un aperçu remarquable : le plus infime aspect de notre quotidien peut être offert à Dieu. Nous pensons souvent que la providence de Dieu ne se manifeste que dans les grands événements, mais elle agit aussi dans nos moindres habitudes et dans l’ordinaire de notre vie : c’est là même que nous pouvons reconnaître la souveraineté et la direction de Dieu, et lui rendre grâce.
« Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et en vérité », déclare 1 Jean 3.18. Jacques 2.17 avertit également : « La foi sans les œuvres est morte ». Dans ces passages, nous retrouvons la même logique : la foi s’exprime par la louange et la reconnaissance, qui doivent ensuite se concrétiser dans l’action, le partage et le service. Nos paroles et nos actes – autrement dit, notre façon de parler et de vivre – doivent être renouvelés en Christ, de sorte que notre reconnaissance à Dieu soit visible. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer de faire resplendir la louange et la reconnaissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie.
En pratique, comment exprimer cette vie de reconnaissance ? Selon les explications du pasteur David Jang, « la reconnaissance commence avec le souvenir de la grâce reçue, et s’achève quand ce souvenir se concrétise en actes ». Autrement dit, tout part de la prise de conscience de ce que Dieu nous a donné : le salut par la croix, l’amour de Christ, l’intégration dans une communauté, de nombreuses bénédictions sous différentes formes. Mais il ne suffit pas d’en conserver uniquement la mémoire : il faut rendre cette reconnaissance visible en actes, la partager avec les autres. Bien sûr, chanter des hymnes et louer Dieu est essentiel, mais y consacrer aussi son temps, ses talents et ses ressources pour servir le Royaume de Dieu et ses semblables, voilà qui constitue une mise en pratique concrète de la reconnaissance.
Par ailleurs, le pasteur David Jang invite fréquemment à prêter attention à notre manière de parler. Il souligne qu’un cœur rempli de gratitude s’entend nécessairement dans nos propos. Dans le monde séculier, nous entendons souvent des murmures, des plaintes, des critiques ou des paroles de désespoir. Mais celui qui rend grâce en toutes choses, au lieu de sombrer dans les jérémiades, sait regarder les difficultés d’un regard positif, pour conclure : « Je crois que Dieu nous accordera sa bonté en toutes circonstances. » Il ne s’agit nullement de nier la réalité ou d’ignorer la douleur, mais de s’accrocher à la paix de Christ, en faisant confiance à la bienveillance de Dieu. Voilà ce que signifie élever un « culte de reconnaissance » par notre bouche, ce qui peut également fortifier la foi et le courage de notre entourage.
Qui plus est, notre comportement se métamorphose lorsque nous sommes animés par la reconnaissance. Quand le cœur n’est pas reconnaissant, nous plaçons facilement notre ego au centre, négligeant la considération d’autrui ou l’engageant à nos dépens. À l’inverse, celui qui rend grâce en tout se trouve comblé de la grâce de Dieu. Il regardera naturellement autour de lui, veillera au besoin d’autrui et s’efforcera de le combler avec joie. C’est une façon de rendre à Dieu l’amour qu’il nous a donné, et surtout d’agir « au nom du Seigneur Jésus », comme l’écrit Paul. Peu importe l’endroit ou les circonstances, même lorsque personne ne nous voit, nous sommes sous le regard de Dieu, et nous pouvons continuer à vivre en étant reconnaissants.
L’histoire de la Thanksgiving (Fête d’Actions de grâce) s’enracine précisément dans cette « vie offerte par la reconnaissance ». En 1620, quand les Pères pèlerins accostèrent sur le Mayflower pour gagner leur liberté religieuse, ils bâtirent d’abord une Église où ils purent célébrer Dieu, puis une école biblique, avant d’assurer leur habitat. Dans ce nouveau monde, ils durent faire face à un rude hiver et à un environnement très hostile. La première récolte fut désastreuse, et beaucoup moururent de faim ou de maladie. Malgré tout, ils continuèrent à offrir un culte de reconnaissance à Dieu, persuadés que dans ces épreuves et cette pauvreté, Dieu était à l’œuvre pour les conduire et les sauver. C’est cet esprit de gratitude, né il y a quatre siècles, qui s’est perpétué jusqu’à nos jours sous forme de la Thanksgiving.
Le pasteur David Jang souligne souvent à quel point la culture américaine est marquée par l’expression « Thank you », et l’explique comme la « trace de l’influence chrétienne ». La reconnaissance est profondément enracinée dans la foi chrétienne. Par conséquent, celui qui réalise la grâce de Dieu agit et réagit habituellement de manière reconnaissante. En remerciant autrui par un « merci », on reconnaît, même de façon implicite, que Dieu est l’acteur ultime du bien opéré à travers les hommes. Pour qu’une culture de la reconnaissance s’enracine, il faut que la paix de Christ habite nos cœurs et que nous aspirions, par nos actes, à rendre gloire à Dieu.
Bien sûr, tout le monde ne célèbre pas la Thanksgiving de la même manière ni ne partage la même signification de cette fête. Cependant, l’essentiel de cette commémoration, c’est de se souvenir de la grâce de Dieu et de lui rendre gloire avec reconnaissance. C’est un exemple précieux pour tous les croyants. Quels que soient notre époque et notre lieu, nous pouvons, nous aussi, nous souvenir de la grâce que Dieu nous a accordée, la partager avec autrui et nous engager davantage pour le Royaume et la justice de Dieu. C’est dans cette même optique que s’inscrit l’œuvre « C12, G20 » promue par le pasteur David Jang, visant à traduire l’amour de Dieu dans la réalité à travers l’Église, l’éducation, l’entraide et la mission. Établir un tel projet et travailler à sa réalisation constitue un exemple concret d’une vie témoignant de la reconnaissance, « en paroles comme en actes ».
Les propos de Paul : « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père » représentent un défi sacré pour nous. La reconnaissance ne doit pas se limiter à la sphère ecclésiale : il faut également l’exprimer dans nos familles, dans nos entreprises, dans la société, et partout où nous allons, en adoptant un langage et un comportement qui honorent Dieu. En vivant ainsi, nous pourrons témoigner de la beauté de Dieu au monde, qui, intrigué par la paix et l’espérance qu’il décèlera en nous, sera attiré vers la voie de l’Évangile.
En outre, la reconnaissance envers Dieu favorise l’unité au sein de la communauté ecclésiale. « À cette paix, en vue de laquelle vous avez été appelés à former un seul corps, soyez reconnaissants » (Colossiens 3.15). Nous formons un seul corps, et lorsque nous adoptons tous une attitude reconnaissante, la communauté n’est plus divisée par les querelles ou les accusations mutuelles, mais tend plutôt à s’édifier dans l’amour, en se soutenant et en se construisant. Paul illustre précisément cet idéal d’une communauté où l’on « s’instruit et s’exhorte mutuellement avec toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans nos cœurs en lui rendant grâce ». Bien que, de nos jours, de nombreuses Églises connaissent conflits et divisions, si la paix de Christ régnait sur tous et si chaque membre s’appliquait à la louange et à la reconnaissance envers Dieu, alors les tensions s’apaiseraient, et l’amour au service les uns des autres grandirait.
La reconnaissance se relie aussi à la foi en l’avenir. Celui qui rend grâce ne se souvient pas seulement des bienfaits du passé, il anticipe que Dieu continuera d’agir en bien à l’avenir. C’est pourquoi il ne cède pas à la plainte ni au mécontentement, même au milieu de l’épreuve. Les Pères pèlerins, malgré leurs grandes souffrances dès leur arrivée dans ce nouveau pays, pouvaient offrir ce culte de reconnaissance précisément parce qu’ils avaient la conviction que Dieu continuerait à agir pour leur bien. Le pasteur David Jang qualifie cela de « semer la graine de la foi par la reconnaissance ». Lorsqu’à la fin d’une année éprouvante, nous l’achevons en rendant grâces, et que nous envisageons la suivante avec la même confiance, Dieu peut alors faire germer une nouvelle vision et produire de bons fruits sur le terreau de notre reconnaissance.
De cette manière, la reconnaissance est à la fois un état de foi embrassant le passé, le présent et l’avenir, et la clé d’un culte qui glorifie Dieu. Le message de Paul dans l’épître aux Colossiens, tout comme celui de 1 Thessaloniciens 5.18 – « Rendez grâce en toutes circonstances » – nous pousse à rendre grâce dans chaque aspect de notre vie, en nous appuyant sur la grâce et la paix déjà données en Christ. Et cette reconnaissance doit s’imprégner de nos paroles et de nos actes. Ceux qui vivent ainsi dans la gratitude transcendent la sphère individuelle et exercent un impact transformateur sur leur communauté et sur le monde. Dans une époque où abondent les plaintes, les disciples qui continuent à chanter la louange avec reconnaissance resplendissent comme des lumières dans la nuit.
Aussi, quand nous célébrons aujourd’hui le culte de Thanksgiving, veillons à ne pas nous limiter à la formule : « Merci, Seigneur, d’avoir préservé cette année difficile ! ». Même si c’est un motif légitime de gratitude, allons plus loin : commençons par remercier Dieu de nous avoir sauvés, de nous avoir réconciliés avec lui, et de nous avoir fait don de la paix éternelle. Efforçons-nous ensuite de manifester concrètement cette reconnaissance dans nos paroles, nos actes, notre culte, nos louanges et notre amour envers nos semblables. Se souvenir des bienfaits de Dieu, c’est-à-dire « la parole de Christ qui demeure en nous et nous remplit », doit être la mélodie de chaque jour de notre vie. C’est ainsi que nous construirons une culture de la reconnaissance au sein de notre communauté ecclésiale, dans la solidarité et la fraternité.
Le pasteur David Jang le répète souvent : « La reconnaissance commence par de petits actes, mais son écho n’a rien de faible. » Non seulement elle impacte positivement notre entourage, mais elle constitue aux yeux de Dieu un culte d’une immense valeur. Parfois, il suffit d’une personne, ou d’une communauté, décidée à vivre dans la gratitude et la louange pour transformer le monde. Dans l’histoire, de nombreux mouvements de réveil spirituel sont nés au sein de communautés pleines de reconnaissance et de louange. De la même façon, les Pères pèlerins, au milieu d’épreuves sévères, n’ont jamais cessé d’adorer et de rendre grâce à Dieu, permettant à cette tradition historique de traverser les siècles. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne laissons jamais la reconnaissance disparaître de notre vie.
L’appel à « faire tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce à Dieu le Père » est un appel à ce que la totalité de notre existence devienne un culte à Dieu. Et pour obéir à cet appel, il nous faut laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs, nous attacher fermement à sa Parole, l’adorer par la louange et les bonnes œuvres, afin de lui rendre gloire. Puissions-nous offrir le culte que nous célébrons aujourd’hui non comme un simple rituel ponctuel, mais comme un acte qui se prolonge dans notre quotidien par une obéissance plus grande, une louange plus profonde et des fruits encore plus beaux de reconnaissance. Partout où nous irons, en paroles comme en actes, que nos vies traduisent notre reconnaissance envers Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C’est là le message profond de Colossiens 3.15-17 et le cœur de la vie évangélique que le pasteur David Jang ne cesse de promouvoir partout dans le monde.
À tous ceux qui sont présents en ce jour, je souhaite que, malgré les difficultés liées à la pandémie de Covid ou malgré vos épreuves et vos peines personnelles, vous puissiez répondre par un « Amen » à l’invitation divine : « Rendez grâce en toutes choses. » Ce n’est certes pas un ordre facile à suivre, mais il devient possible dès lors que nous prenons conscience de la paix de Christ qui habite déjà en nous. Et forts de cette paix, nous pouvons, dans chacun de nos actes et chacune de nos paroles – « en parole ou en œuvre » –, rendre grâce à Dieu le Père. Ainsi, en dépit du désordre de notre époque, nous pourrons être « sel de la terre et lumière du monde ». Nous avancerons avec foi vers les plans plus grands que Dieu réserve pour l’année à venir, et ainsi de suite.
Puissions-nous maintenant laisser notre reconnaissance, notre culte et notre louange se déployer dans nos familles, nos Églises, la société et les nations. Suivons l’exhortation du pasteur David Jang : que notre reconnaissance et notre louange deviennent un « sacrifice » concrétisé par nos actes, visant à promouvoir la justice, l’amour et la paix voulus par Dieu. Au lieu d’une simple louange verbale, adoptons une adoration authentique qui mobilise toute notre vie. Alors, le Royaume de Dieu se manifestera déjà au milieu de nous et nous pourrons offrir des actions de grâce toujours plus abondantes. En marchant avec persévérance sur ce chemin, nous entrerons assurément dans la nouvelle année sous de riches bénédictions et des fruits accordés par Dieu. Les bénédictions promises à ceux qui rendent grâce en toutes choses ne sont pas vaines. Ensemble, arpentons joyeusement cette route de la foi et adressons sans relâche au Père nos offrandes de reconnaissance. Amen.